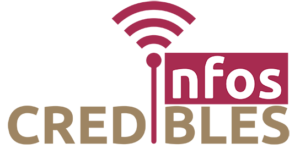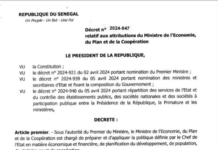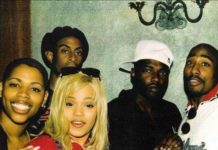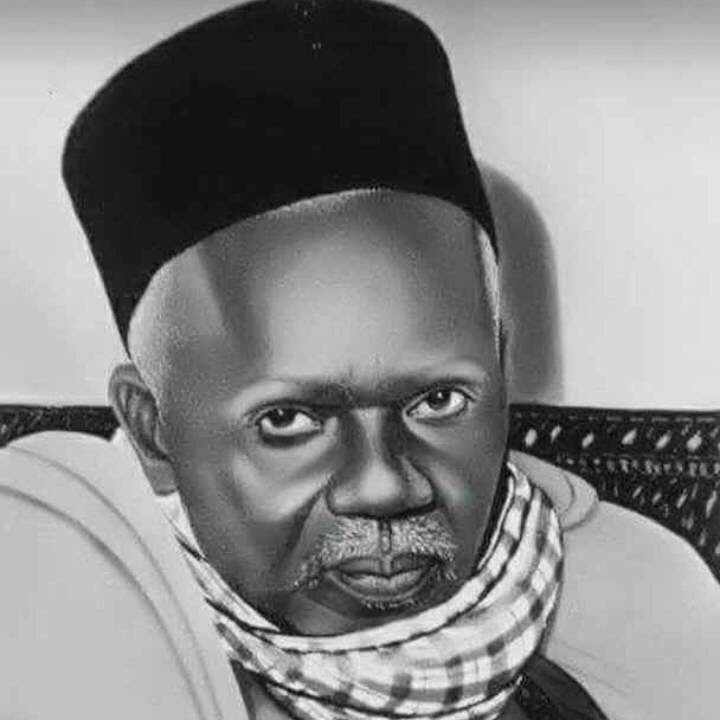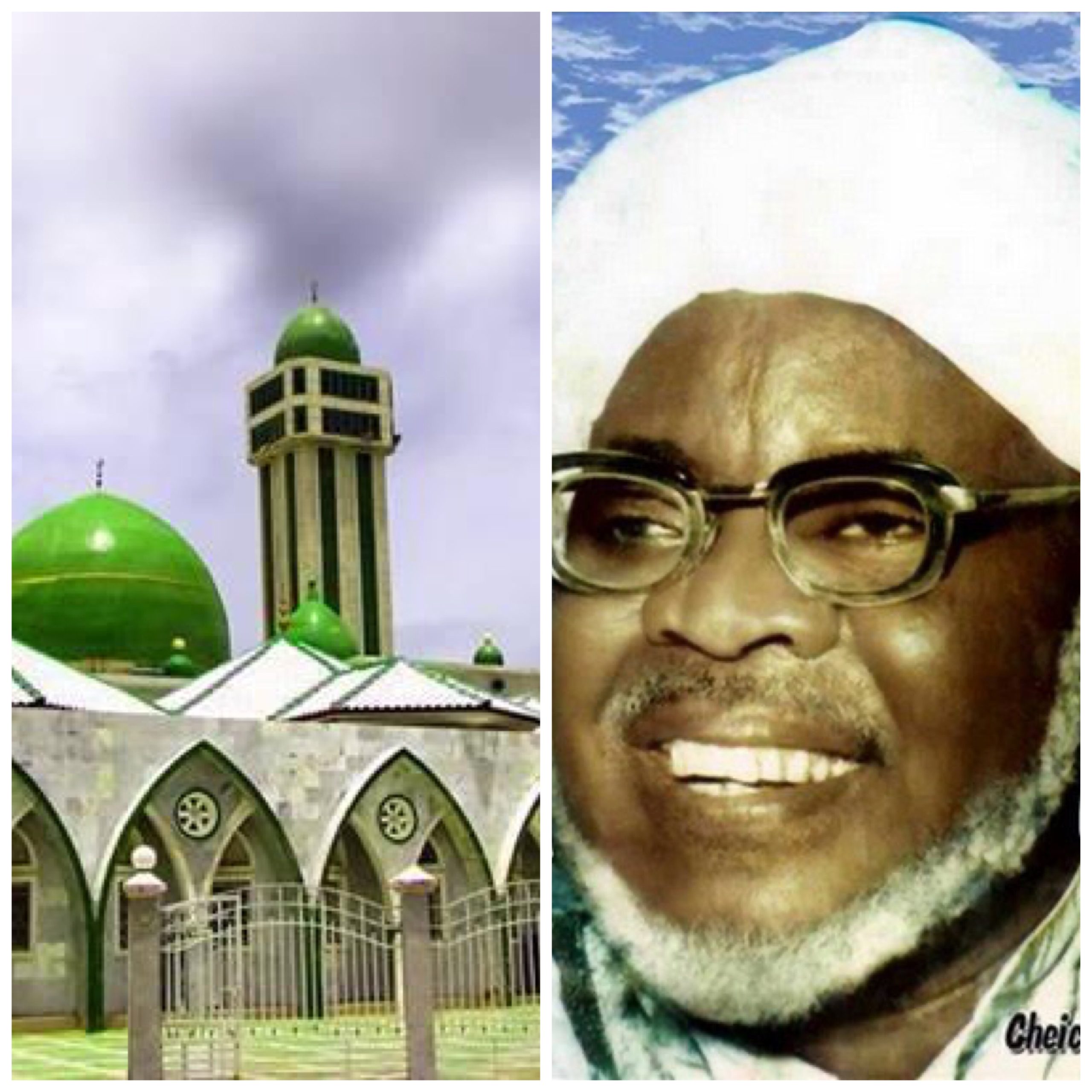La Banque africaine de développement (BAD) a récemment proposé une révision du calcul du produit intérieur brut (PIB) des pays africains afin d’inclure la valeur de leurs ressources naturelles, telles que les forêts, les minerais, et les stocks de poissons. Cette initiative vise à mieux refléter la richesse du continent et à réduire la pression exercée par la dette. En 2018, le PIB officiel de l’Afrique était estimé à 2 500 milliards de dollars, un chiffre bien inférieur à la valeur totale de son capital naturel, évaluée à 6 200 milliards de dollars. Cette différence significative met en lumière le potentiel inexploité de ces ressources naturelles, qui, selon la BAD, pourraient redéfinir l’évaluation des économies africaines à l’échelle mondiale.
L’intégration des ressources naturelles dans le calcul du PIB permettrait non seulement de mieux refléter la véritable richesse des pays africains, mais aussi de rendre la dette plus supportable. L’initiative pourrait ainsi avoir un impact majeur sur la manière dont les créanciers et les investisseurs perçoivent les économies africaines, en tenant compte de leur potentiel écologique. Cependant, la mise en œuvre de cette révision soulève plusieurs défis, notamment celui de la monétisation effective de ces ressources naturelles. La question de leur valorisation dans les échanges mondiaux reste complexe, en particulier lorsqu’il s’agit d’utiliser des mécanismes tels que les crédits carbone pour financer la réduction de la dette.
L’une des préoccupations majeures réside dans le fait que la dette extérieure de l’Afrique subsaharienne a explosé ces dernières années, passant de 150 milliards de dollars à 500 milliards de dollars au cours des 15 dernières années. Bien que l’inclusion des ressources naturelles dans le calcul du PIB puisse améliorer la situation économique, le processus de transformation de cette richesse naturelle en instruments financiers tangibles reste un défi majeur. L’utilisation de mécanismes tels que les crédits carbone, censés valoriser les ressources naturelles et ainsi générer des financements, peine à convaincre. Si certains pays, notamment la Chine, soutiennent cette approche, elle demeure néanmoins limitée par des difficultés de mise en œuvre et de gouvernance.
Le soutien international à cette initiative reste encore fragile. Plusieurs acteurs du marché financier et des bailleurs de fonds restent sceptiques quant à la viabilité de ce modèle, notamment à cause des enjeux liés à la gestion durable des ressources naturelles et des difficultés à évaluer correctement leur valeur sur le long terme. Toutefois, si des solutions efficaces sont trouvées, cette révision pourrait transformer la manière dont le monde considère la richesse de l’Afrique et offrir de nouvelles perspectives pour le financement de son développement.
En fin, bien que l’inclusion des ressources naturelles dans le calcul du PIB semble être une démarche prometteuse pour redéfinir l’évaluation des économies africaines, elle soulève encore des questions complexes sur la gestion de ces ressources et la manière de les monétiser. Ce projet pourrait cependant jouer un rôle clé dans l’atténuation de la dette du continent et dans l’attraction d’investissements, tout en mettant en lumière la richesse écologique de l’Afrique, souvent négligée dans les calculs économiques traditionnels.