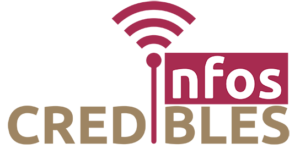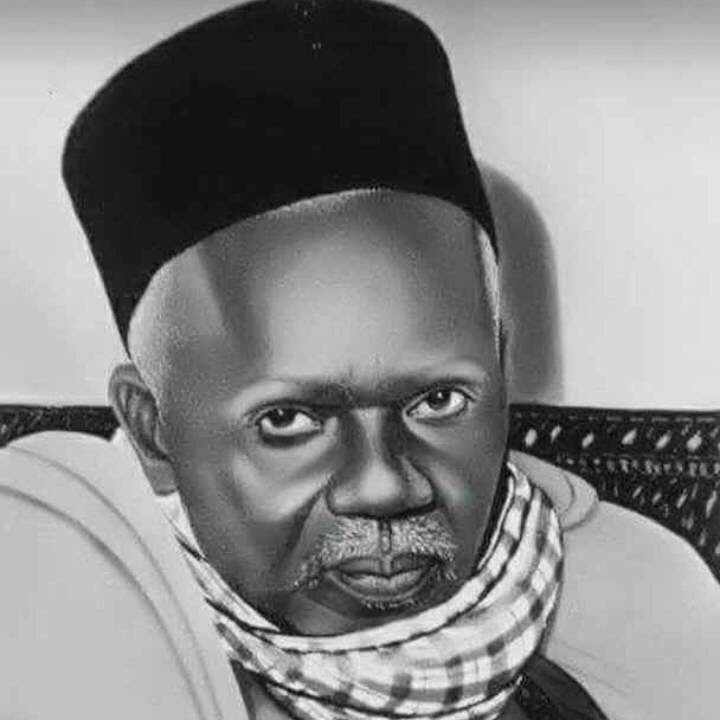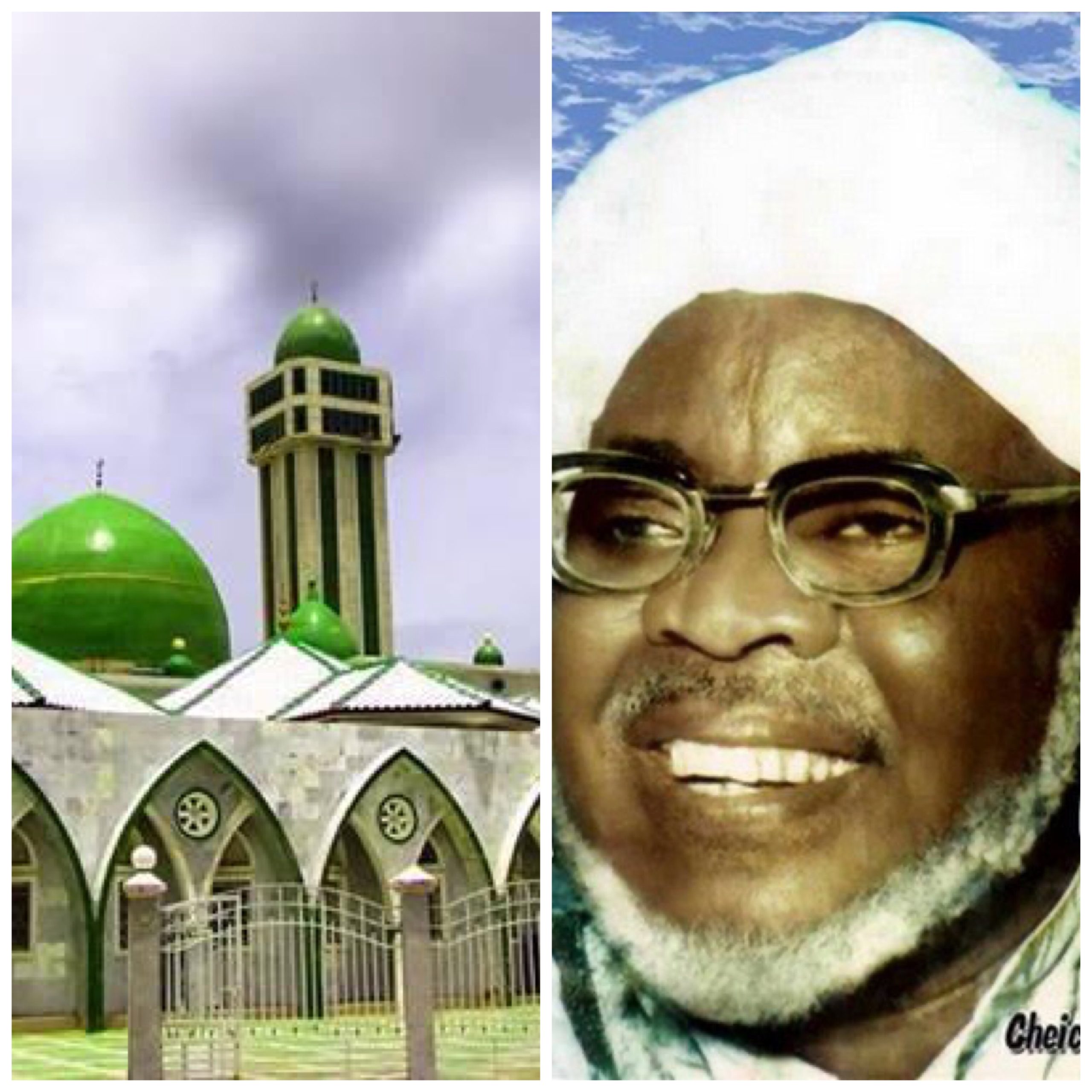Comment, avec tous leurs moyens, les institutions financières internationales n’ont-elles pas réussi à mieux accompagner le développement de l’Afrique ? Pour Papa Demba Thiam, économiste, la réponse est, entre autres, dans une certaine bureaucratie. Explication.
Fin observateur des économies africaines dans leur fonctionnement et leurs rapports avec les institutions financières internationales, Papa Demba Thiam s’interroge haut et fort sur les raisons qui font que l’Afrique n’a toujours pas décollé. Professeur, chercheur et investisseur, entrepreneur privé pour le développement des chaînes de valeurs, avant de travailler comme consultant international au service des gouvernements suisse et allemand, le Dr Papa Demba Thiam a été coordonnateur puis directeur de projets pour le développement du secteur privé et du commerce dans les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) en liaison avec l’Union européenne, consultant international auprès de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et auprès de la Commission européenne, fonctionnaire à l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE) et économiste principal au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. De mai 2003 à octobre 2016, le Dr Papa Demba Thiam a été fonctionnaire à la Banque mondiale avant de quitter cette dernière institution en retraite anticipée. Il développe actuellement des services de conseil en partenariats stratégiques public-privé sur les chaînes de valeurs en développement industriel fondés sur la transformation des ressources locales y compris par le développement d’agglomerations industrielles urbaines liées aux économies nationales, les parcs industriels multifonctions et les parcs agro-industriels. Donc, de quoi comprendre le fonctionnement de la machine de coopération économique multilatérale de l’intérieur. Se confiant au Point Afrique, il met le doigt sur les sentiers de dysfonctionnement dans lesquels les économies africaines ont erré et qui les ont conduites à connaître la situation qui est la leur aujourd’hui.

Le Point Afrique : Comment expliquez-vous que malgré toutes les richesses dont elle dispose, l’Afrique en soit à la place qu’elle occupe aujourd’hui dans le concert des nations ?
Papa Demba Thiam : À mon humble avis, toute économie pour être viable doit être bâtie sur ses forces. Cela n’a pas toujours été le cas pour la grande majorité des pays africains. Pourtant, on ne peut citer aucun pays africain qui n’ait pas de ressources enfouies dans son sous-sol et dans ses plans et cours d’eau, étalées sur son sol et potentiellement dérivables par l’exploitation de ses positions géographiques. L’inertie et l’inaction me semblent d’abord avoir relevé de la culture de la chasse et la cueillette qui avaient déjà caractérisé l’exploitation coloniale de beaucoup de pays africains. Cette culture a essentiellement relevé de la prédation en moindre effort avec un niveau de satisfaction très bas de la part des exploitants coloniaux, ensuite, des pays devenus des États indépendants.
Pour preuve, les colonisateurs semblent n’avoir même pas développé de stratégies compétitives en matière de prédation, pour savoir quoi vraiment mieux exploiter et comment le faire de la manière la plus efficiente. À titre d’exemple, on peut se demander pourquoi le Sénégal ne découvre ses importants gisements de pétrole et de gaz que seulement « maintenant », quand on sait que les premiers échanges entre le Sénégal et l’Europe datent de 1444, lorsque les Portugais ont atteint l’embouchure du fleuve Sénégal, qu’après 1600, les Hollandais et les Français en ont chassé les Portugais, et qu’à partir de 1700 la France a commencé à dominer la « région » du Sénégal, militairement, administrativement et économiquement.
Pourtant, gaz et pétrole ont toujours été là… La preuve, il fallait juste penser que le plateau continental du Sénégal appartenait aux mêmes plaques tectoniques que celles de pays producteurs de pétrole qui sont en face du Sénégal, en Amérique latine. Comment pouvait-on ne pas imaginer que s’il y a du pétrole au nord, au sud et à l’ouest du Sénégal, sur les mêmes plaques tectoniques d’aujourd’hui et d’avant, il n’y en aurait pas au Sénégal ? Il s’agit de constater qu’il n’y avait réellement aucune envie de piller le Sénégal d’une manière structurée et intelligente. C’est d’ailleurs pourquoi le colonisateur n’a pas vu l’intérêt de l’exploitation des ressources halieutiques du Sénégal, pariant plutôt sur la culture de l’arachide en sols moins adaptés, pour faire tourner ses huileries. Parce que la France n’avait pas comme vision de s’installer durablement et structurellement dans ses colonies. Ses structures étaient « provisoires » et n’étaient pas appelées à durer.
En comparaison, les colons en Afrique du Sud y ont développé des structures économiques cohésives et cohérentes avec leur volonté d’y rester pour toujours. En règle générale, partout où les colons ont decidé de s’établir, ils y ont développé, ne serait-ce que des niches de « structures de développement économique ». Sinon, leurs seuls programmes et structures installés devaient ne servir qu’à une exploitation conçue pour être limitée dans le temps.
Après les indépendances africaines, les nouveaux gouvernants n’ont pas souvent conçu de stratégies, programmes, projets et interventions pour créer les bases d’une croissance économique permettant la participation du plus grand nombre dans le temps et dans l’espace. Les économistes africains et /ou « africanisants » (pour ne pas dire « tiers-mondistes ») les plus engagés en matière de développement économique étaient plus des révoltés idéologiques qui combattaient ce qu’ils appelaient « impérialisme », « néocolonialisme », « ordre économique international » etc. Ce faisant, ils avaient jeté le bébé avec l’eau du bain en étant occupés à produire des reflexions combattantes contre le « capitalisme et les firmes multinationales. Une superbe occasion ratée pour utiliser leur puissance intellectuelle pour aider à créer les structures de base et les programmes permettant de mettre en exergue les opportunités économiques du continent et les mettre en valeur pour le bien de tous.
Cette situation n’a pas donné d’autres options aux nouveaux gouvernants que d’administrer les rares circuits de production (non-compétitive) de richesses (mal partagées). Ces dernières ont plutôt servi, dans les pays africains, à entretenir une nouvelle classe de chefs-maîtres-administrateurs, d’où l’appétit de beaucoup de personnes à devenir des fonctionnaires. Et le pillage inintelligent de continuer…
Sur le plan économique, l’Afrique est caractérisée par un très important secteur informel qui occupe d’ailleurs l’essentiel de la population. Comment expliquez-vous la persistance de ce phénomène ?
Le développement du secteur dit « informel » me semble la réponse spontanée et naturelle à l’échec de l’économie dite formelle, si tant est qu’on puisse parler d’échec parce que les politiques de développement de l’économie formelle en Afrique ne me semblent pas encore toujours se confondre avec celles nécessaires à la croissance inclusive créatrice d’emplois et de richesses partagées. L’économie est comme un cours d’eau. Si vous bloquez un cours d’eau, il se fait un nouveau lit ailleurs pour toujours continuer de couler.
On voit de plus en plus de gens très instruits par de grandes écoles, dans le secteur informel. Cela a l’air paradoxal, mais je dirais que c’est « normal » au sens de la « nécessité » de Hegel. Parce qu’un opérateur économique investit dans des activités dans lesquelles les opportunités économiques sont claires et les risques connus et gérables. Or la culture de prédation des administrations qui vivent de taxes et d’impôts poussent les opérateurs à se soustraire des circuits formels qui les exposent au fisc. Le problème est surtout qu’ils considérent les paiements au fisc comme des frais inutiles et évitables, mais pas comme des coûts. Je définis un coût comme un sacrifice de ressources, le but étant de gagner plus que l’on sacrifie. Si vous me dites de sacrifier 10 pour gagner 100, j’aurais tendance à sacrifier 100 pour gagner 1000. Par contre, mon réflexe naturel sera d’éviter des dépenses qui ne rapportent pas. Je les ferai si nécessaire, mais j’aurai tendance à les limiter au minimum. Vu sous cette perspective, les États africains ont intérêt à établir ce que j’appelle des systèmes de « fiscalité de développement » dont tout opérateur économique devrait raffoler si ces systèmes permettent de l’insérer durablement dans des chaînes de valeurs construites par le financement public.
Il faut aussi dire qu’en Afrique, le secteur informel a developpé des modes d’organisation du travail par une culture d’entreprise qui est en bonne adéquation avec la culture des acteurs qui y travaillent. Ils ont les mêmes valeurs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces entreprises, ce qui y facilite la culture et les réflexes d’appropriation.
Enfin, il faut dire que dans certains cas (de plus en plus nombreux), ce sont des bureaucrates, supposés être des gardiens du secteur formel, qui se lancent dans des activités informelles. C’est le cas des boutiques et/ou d’ateliers de tailleurs dans des garages de ces maisons des agglomérations urbaines dans lesquelles les résidents ont bénéficié de programmes d’acquisition de logement en tant que fonctionnaires solvables. D’autres bureaucrates investissent dans des systèmes de transport informel. Il y a d’autres exemples de fonctionnaires-bureaucrates-entrepreneurs informels.
Que faudrait-il pour que les administrations ainsi que les entreprises telles qu’elles existent aujourd’hui en Afrique soient branchées avec l’Afrique réelle ?
Parlons d’abord des administrations qui sont, en principe, parties des institutions, c’est-à-dire des murs-porteurs d’un État de droit. Pourtant, la perversion de la rationalité des institutions est devenue un mode de fonctionnement culturel qui semble accepté en Afrique comme une « norme ». Cela n’a plus l’air de choquer grand monde. Partout dans le monde et d’une manière générale, le pouvoir est détenu par ceux qui contrôlent les moyens de la violence. Dans les pays plus démocratiques, les moyens de la violence sont dans l’assujetissement de l’individu aux règles et procédures dont les institutions sont les garantes. De fait, les moyens de la violence sont contrôlés par la conscience collective de ce que tout le monde croit juste et accepte. Dans beaucoup de pays d’Afrique et pendant longtemps, les moyens de la violence ont été directement ceux par la détention d’armes. C’est le cas à travers des coups d’État et d’autres formes de viols de souveraineté populaire. Il faut d’ailleurs noter que c’est paradoxalement dans ce genre de pays à régime fort qu’il a été plus facile de faire accepter les recettes des programmes d’ajustement structurel et de stabilisation, même si certains des dirigeants de ces pays ont soutenu avoir pris les armes pour renverser des gouvernements parce qu’ils voulaient libérer leurs peuples du « néo-colonialisme incarné par un ordre international injuste et inéquitable ».
Il faut aussi noter que la décennie des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel nés du « Consensus de Washington » et de ses modes d’administration pompeusement appelés « gouvernance » a vu se fabriquer tellement de pauvreté en Afrique que des peuples sont descendus dans les rues pour chasser des dirigeants « forts », y compris par l’instauration de « conférences nationales souveraines ». Les jeunesses africaines se sont alors mises à rêver de démocraties par des institutions fortes. Cruelle désillusion : beaucoup de ces institutions ont été dévoyées pour servir des hommes forts, arguant du fait que la démocratie s’exprime par le respect des lois et des procédures établies. C’est cela qui permet aussi d’expliquer pourquoi des institutions démocratiques peuvent se muer en instruments de dictature « légitime » en pipant les dés avant le jeu. Qu’est-ce qui permet à des dirigeants de le faire et à leurs administrés de l’accepter ? C’est aussi l’acception que les Africains ont de la notion de chef. Être chef est une aspiration normale, un moyen de reconnaissance sociale. Quoi de plus évident comme opportunité que de devenir chef, que de s’emparer des rênes d’une institution pour s’en servir comme instrument de pouvoir personnel, surtout si elle permet de changer et/ou tailler des lois sur mesure, auxquelles l’individu doit se soumettre ?
Dans le cas de l’entreprise informelle, la notion de chef et le culte du chef demeurent compatibles avec la poursuite de ses objectifs économiques et sociaux. C’est ce qui crée sa cohésion par une culture d’entreprise comprise et acceptée de ses membres. Ses membres sont dotées de la même mentalité à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Donc pas de choc de cultures. Par contre, dans l’entreprise formelle en Afrique, l’individu est souvent sujet à deux cultures antinomiques. Par exemple, en dehors de l’entreprise peut prévaloir une culture gérontocratique qui fait que l’individu obéit et se défère à plus âgé que lui. Mais le même individu peut être le chef d’un plus âgé que lui, ce qui peut créer des situations de conflits larvés qui empêchent le développement d’une culture d’entreprise commune à tous les acteurs.
En résumé, autant la culture de la notion de chef peut être un facteur de cohésion dans l’entreprise informelle ou un facteur de tensions dans l’entreprise formelle, autant elle peut ouvrir la porte à la transformation d’institutions conçues pour être démocratiques, en des instruments structurels de dictature durable. Le tout relève de l’état de raison dominant que je définis comme l’ensemble des choses que la plupart des membres d’une communauté croient justes. Les pays à marchés émergents ont dû éduquer et ajuster leurs états de raison pour créer des cultures institutionnelles et d’entreprises qui transcendent toutes leurs structures économiques et sociales. C’est ce qui fait que l’entreprise chinoise fonctionne sur des modes culturels différents de l’entreprise coréenne, française ou américaine. Les modèles d’entreprise en Afrique doivent naître de logiques de développement économique inclusif. Ceci permettrait de créer assez de sécurité pour les populations et construire des institutions démocratiques tout en développant des programmes pouvant assurer la transition du secteur informel vers une économie moderne intégrée et transparente.
Au-delà de l’économique, il y a le politique. Comment faire pour mieux les imprégner de valeurs africaines dans lesquelles acteurs économiques et citoyens se reconnaîtront, et pour lesquelles ils accepteront d’être noblement au service des missions qui leur sont confiées ?
L’économique et le politique entretiennent des relations autant bijectives que dialectiques. Les sociétés dont les populations connaissent un niveau de vie élevé dans le cadre d’une croissance inclusive sont plus disposées à engager davantage de concertations politiques apaisées et inclusives. L’expérience montre d’ailleurs des corrélations assez récurrentes entre le niveau de développement inclusif et la démocratisation progressive. Mais je voudrais être clair : il ne s’agit pas de dire qu’il faut des régimes forts pour d’abord créer de la richesse partagée, sécuriser les populations et ensuite démocratiser. Je crois plutôt qu’un pays peut créer les processus et les contenus pour de larges consultations décentralisées, sur des modes de transformation de ses ressources en produits à forte valeur ajoutée, pour permettre la participation du plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre d’activités économiques et sociales auxquelles elles attachent de la valeur. C’est justement une très grosse opportunité à saisir pour inculquer des cultures démocratiques et des cultures d’entreprise homogènes et congruentes en Afrique. Il faut que les populations y trouvent leur compte. Alors l’Afrique deviendrait une terre de plein emploi qui importerait même de la main d’œuvre.
L’Afrique travaille beaucoup avec les institutions internationales. Certaines sont plus politiques, comme l’ONU, d’autres plus économiques, comme la Banque mondiale. Ont-elles contribué d’une façon ou d’une autre à améliorer la situation en Afrique en aidant à plus de démocratie ou à plus de prospérité économique ?
Une longue histoire de désillusions. Je demande la permission de la franchise. Beaucoup d’institutions multilatérales ont perdu le contrôle des moyens opérationnels de leur raison d’être initiales. Certaines sont devenues des institutions bureaucratiques dévoyées qui ont même contribué à fabriquer de la pauvreté en Afrique, ce qui a alimenté moult mouvements irrédentistes et de l’immigration massive, ce qui a aidé à amener des populistes au pouvoir, dans beaucoup de pays dits développés. Multilatéralisme, oui. Mais quel multilatéralisme ? Permettez-moi de vous donner un exemple de la perversion de la rationalite initiale des institutions multilatérales.
Fin des années 1960 : la sècheresse alliée aux crises pétrolières qui ont suivi ont toutes deux fini par rendre des administrations africaines déjà prédatrices, exsangues et surendettées. On n’a alors rien trouvé de mieux que demander à d’autres bureaucrates apathiques d’appliquer des programmes dits de « stabilisation » et d’« ajustement structurel » qui, pour régler les problèmes budgétaires des États africains, ont simplement démantelé les maigres structures et tissus socio-économiques qui y existaient. La recherche et l’éducation et la formation en ont aussi pâti tout autant que les infrastructures qui n’ont été ni maintenues ni développées, et nous voilà entrés en régime de fabrication de pauvreté avec l’installation durable de « structures de sous-développement ». Pour faire court, la situation de dépendance des États africains envers des bureaucraties multilatérales (et bilatérales) s’est accentuée au fil du temps, ce qui a enlevé aux États africains, l’initiative, la programmation et l’action en matière de politique de développement.
Que l’on cesse d’appeler « stabilisation » et/ou « ajustement structurel », les programmes que les pays africains ont avec les institutions financières multilatérales, lesquelles les ont rebaptisés « appui budgétaire », « facilités » ou « prêt de financement de politique de développement » et autres. Ces mêmes programmes continuent d’être développés et livrés par la même caste de bureaucrates qui n’ont pas appris à faire autre chose. Ils contiennent les mêmes types d’interventions avec leurs « conditionnalités » rebaptisées « déclencheurs ».
Le plus grave est la transhumance entre bureaucrates d’institutions nationales, bilatérales et internationales qui arrive à produire les mêmes types de décideurs parfois comme « clients », parfois comme « fournisseurs » d’aide au développement. Ceci permet d’intégrer et harmoniser la colonisation des instances de décision par ceux que j’appelle les « carriéristes de la fabrique de pauvreté ». Ils résistent à toute forme de leadership et d’innovation pour protéger leurs intérêts vitaux. La perversion même de l’idéologie que les bureaucrates-carriéristes brandissaient avant de s’engager dans le travail de développement.
Quels sont les arguments qui corroborent votre jugement ?
Écoutez, je ne crois pas être le seul à penser de la sorte. J’ai été un gros rebelle dans le monde du développement. C’était le cas à la Banque mondiale que j’ai décidé de quitter il y a tout juste deux ans, en faisant prévaloir mes droits à une retraite anticipée. J’y suis allé depuis l’OCDE en me disant qu’on ne pouvait pas laisser une institution avec des moyens aussi importants entre les mains de bureaucrates-carriéristes qui prennent des décisions à conséquences dramatiques, sur la base de feuilles de calculs, sans se soucier des réalités socio-économiques des populations impactées par leurs décisions.
Je me suis dit qu’on ne pouvait pas fermer cette institution et que même des dirigeants africains qui ne croient pas dans la capacité de cette institution à régler les problèmes de développement, ont quand même besoin d’accéder aux ressources de cette institution qui leur appartient aussi et dont ils sont aussi clients. Je savais que de par mes écrits et prises de position publiques contre les politiques de l’institution, j’y serais attendu de pied ferme par les gardiens du temple. Donc, je n’étais pas intéressé d’y faire une carrière « politique » en jouant à l’Africain heureux d’être là et prêt à dire oui à tout pour garder son job et ses avantages. Ce sont les pires fossoyeurs de l’Afrique.
Mon but était plutôt d’y introduire le développement industriel en Afrique coûte que coûte. J’ai donc repris un projet moribond, pour ne pas dire un éléphant blanc au Ghana, pour diriger une équipe mixte gouvernement du Ghana-Banque mondiale et tourner le design du projet pour en faire un modèle de succès pour les projets financés par lAssocisation internationale de développement (AID). Il s’agit du Ghana Trade and Investment Gateway Project. Avec seulement 50 millions de dollars américains, les résultats officiels de ce projet tels que publiés par la Banque mondiale et le gouvernement de Ghana indiquent qu’il a contribué à créer 305 000 emplois, y compris avec un parc industriel faisant partie d’un centre de croissance multipolaire avec le port de Tema rénové. Les résultats indiquent aussi que ce projet a généré plus de 1 200 autres projets pour un montant d’investissements privés qui se montent à plus de 12 milliards de dollars américains au Ghana.