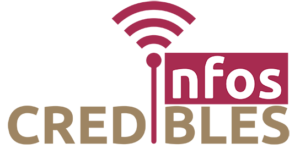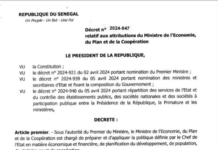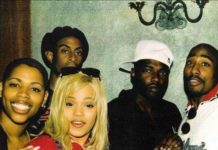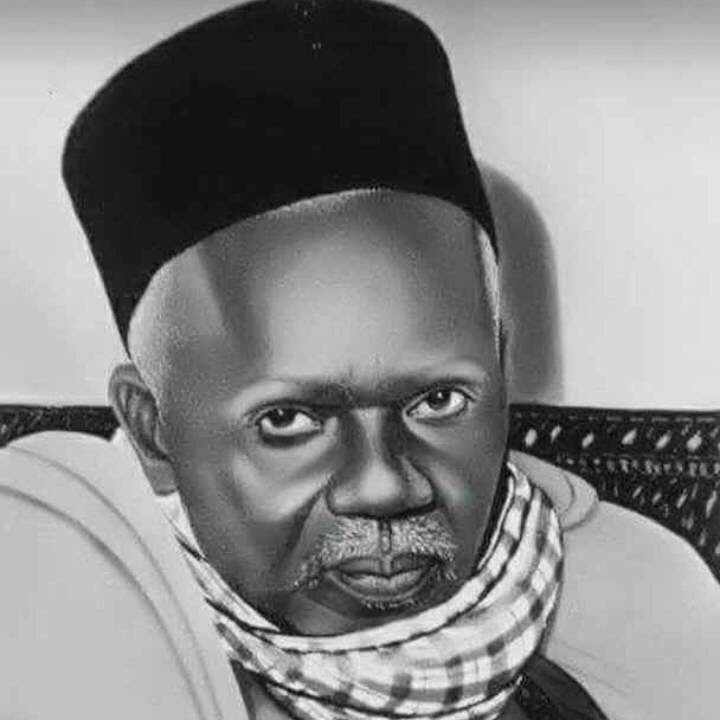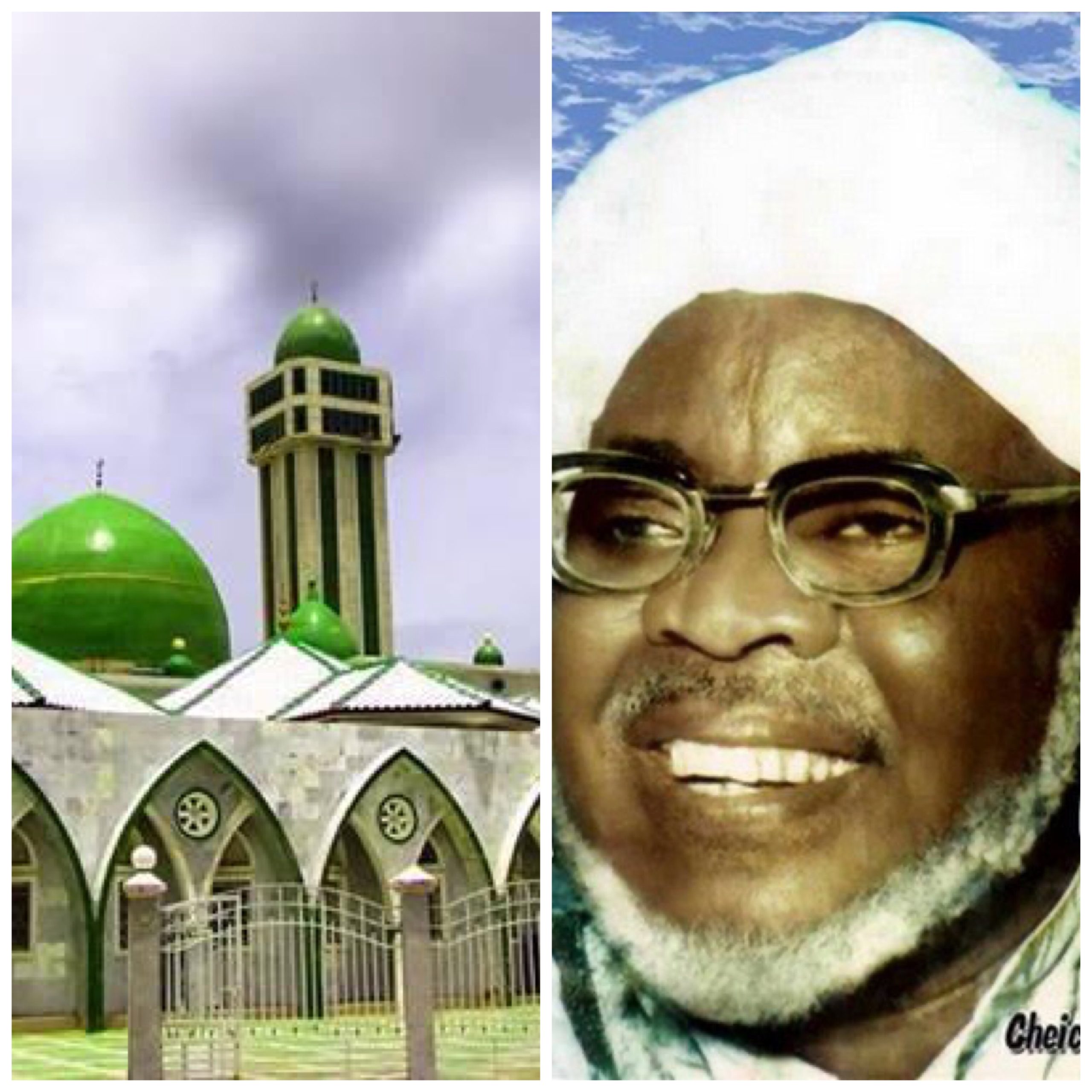Du 27 au 28 mars 2025, l’Université Catholique de Madagascar a accueilli la troisième édition du Forum économique des dirigeants d’entreprises et des cadres chrétiens d’Afrique. Cet événement majeur a rassemblé des acteurs de seize pays, explorant le thème : « Les entreprises africaines face aux défis de la souveraineté économique ». Si les débats ont couvert des enjeux variés, le sixième panel intitulé « Intégration juridique : acte ou abandon de souveraineté ? Cas de l’OHADA », a particulièrement retenu l’attention, soulevant des questions très importantes sur la souveraineté juridique et les mécanismes d’intégration régionale.
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), qui regroupe actuellement 17 États africains, a été au centre des échanges lors de ce panel juridique. La question posée par les intervenants sur l’adhésion à l’OHADA constitue-t-elle une véritable menace pour la souveraineté juridique des États africains, ou au contraire, un levier pour renforcer la sécurité juridique et la stabilité des affaires dans la région ?
Rindra Harizo, docteur en Droit privé à l’Université de Montpellier et point focal de l’OHADA à Madagascar, a ouvert le débat en rappelant les missions de l’OHADA pour offrir un cadre juridique harmonisé et sécurisé pour les affaires, permettant ainsi une meilleure attractivité pour les investisseurs étrangers. Elle a insisté sur le fait que l’OHADA, loin d’abandonner la souveraineté des États membres, œuvre au contraire pour la renforcer en assurant une stabilité juridique nécessaire à la croissance économique.
Cependant, la réalité de cette intégration suscite des interrogations. La souveraineté juridique, fondement même de l’indépendance des États, pourrait-elle se voir diluée au profit d’une gouvernance supranationale ? Certains experts pointent que l’harmonisation des législations dans le cadre de l’OHADA pourrait conduire à une uniformisation qui ne tiendrait pas compte des spécificités locales. En effet, selon une étude menée par le professeur en droit international économique, Jean-Marc Ajavon, la mise en œuvre de certains instruments OHADA a parfois engendré une marginalisation des lois nationales dans des secteurs cruciaux comme l’agriculture ou l’industrie, où les besoins juridiques locaux sont souvent complexes et spécifiques.
Malgré ces préoccupations, une large majorité des intervenants, notamment les juristes et les dirigeants du secteur privé malgache, se sont exprimés en faveur de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA. Le Consortium Malagasy pour l’OHADA, représentant des entités telles que le Groupement des Entreprises de Madagascar et le FIVMPAMA, a clairement exprimé son soutien à une telle intégration. L’argument principal avancé par ces acteurs reste celui de la sécurisation des investissements et des transactions commerciales dans un contexte régional de plus en plus mondialisé.
Un des points essentiels soulevés lors des débats a été celui de l’amélioration de l’environnement des affaires à Madagascar. Selon une étude récente de la Banque Mondiale, les entreprises dans les pays membres de l’OHADA bénéficient d’une réduction significative des coûts de transaction, avec un indice de facilité de faire des affaires qui s’est amélioré de 40 % depuis l’adhésion des premiers pays. Un tel cadre juridique pourrait ainsi constituer un levier stratégique pour attirer des investissements étrangers, particulièrement nécessaires dans un contexte où Madagascar cherche à diversifier son économie et à renforcer sa position dans la zone de l’Afrique subsaharienne.
À l’échelle régionale, les chercheurs en droit économique soulignent les tensions qui existent entre les avantages de l’intégration juridique et les risques de domination par les grandes puissances économiques. La question de la souveraineté juridique soulève en effet des préoccupations plus profondes sur le contrôle des ressources économiques, particulièrement dans les secteurs stratégiques comme l’énergie et les matières premières. Le professeur Ramarolanto-Ratiaray de l’Université d’Antananarivo a averti que, si l’OHADA a permis un développement juridique dans des domaines comme la protection des investisseurs, il reste encore un défi à relever pour éviter une forme de néocolonialisme économique, où des acteurs extérieurs pourraient profiter de l’harmonisation des règles au détriment des intérêts locaux.
D’un point de vue macroéconomique, une analyse réalisée par le chercheur indépendant Mohamed Bamba montre que l’adhésion à des structures supranationales comme l’OHADA a des effets contrastés. Si, d’un côté, la région bénéficie de mécanismes de protection juridique plus robustes, de l’autre, les entreprises locales ont du mal à rivaliser sur des marchés où les règles sont uniformisées et souvent orientées vers les pratiques commerciales internationales dominantes.
En définitive, le débat sur l’adhésion de Madagascar à l’OHADA se résume à une question centrale sur comment concilier les impératifs d’une souveraineté juridique nationale avec la nécessité d’une intégration économique régionale ? Si l’OHADA peut assurément renforcer la sécurité juridique des États africains et stimuler les investissements, elle soulève également des inquiétudes sur la protection des intérêts locaux. La souveraineté économique, dans ce contexte, ne doit pas se limiter à une simple question de prérogatives juridiques, mais s’étendre à un contrôle plus large des ressources économiques et stratégiques des nations africaines. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si Madagascar et d’autres pays africains sauront trouver un équilibre entre ces deux impératifs. Zaynab SANGARÈ