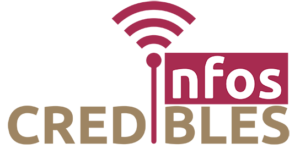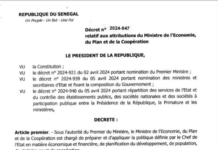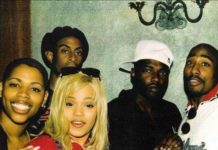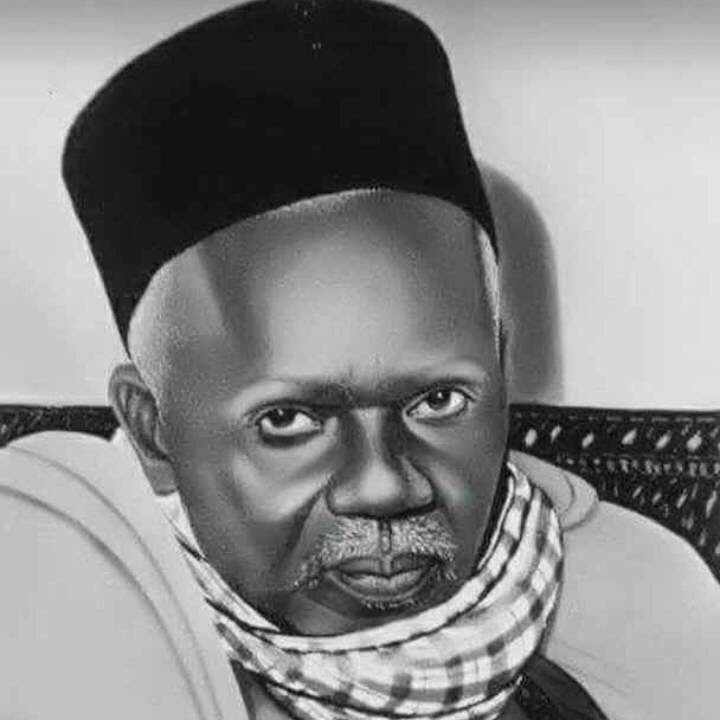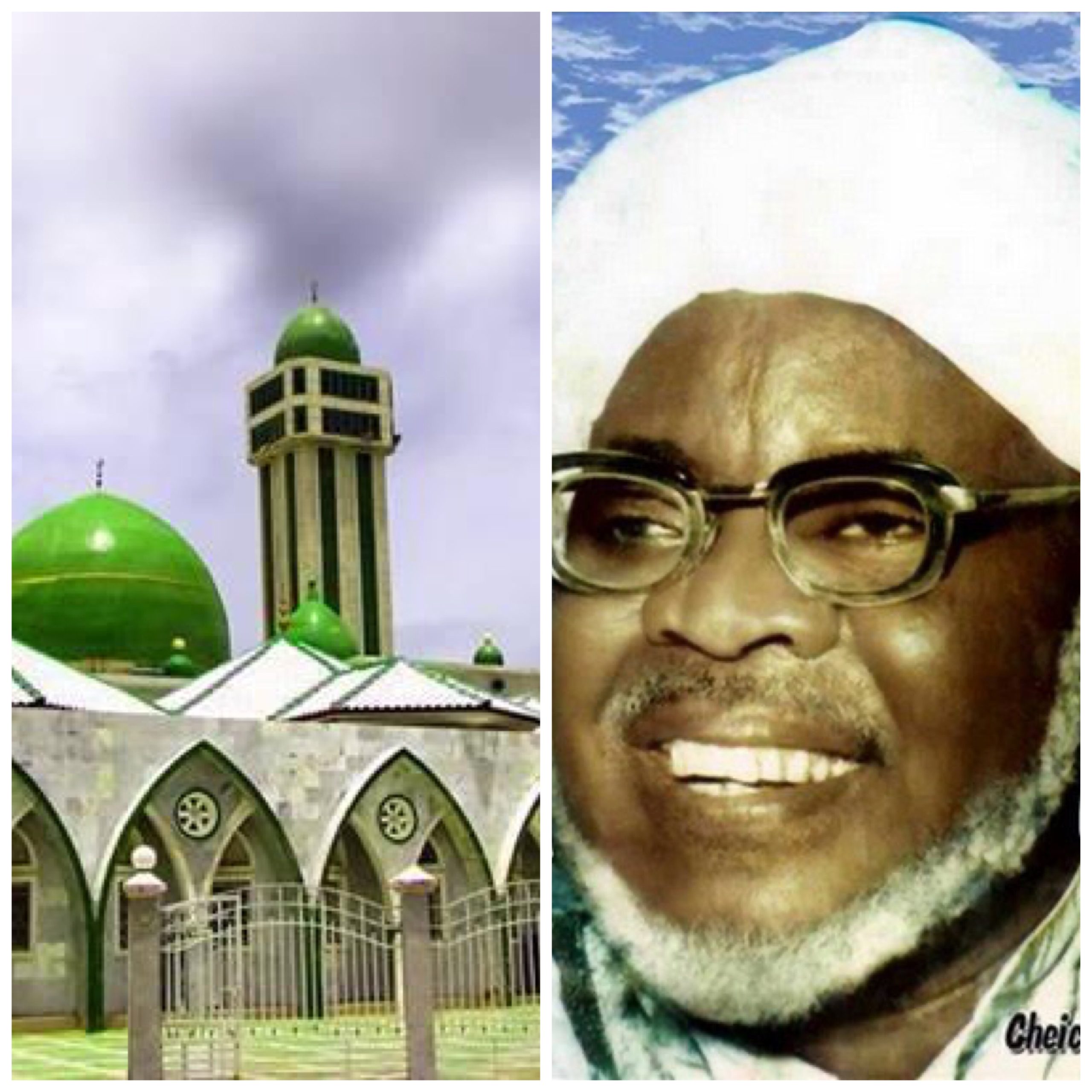Le 25 mars, à l’occasion de la Journée internationale du souvenir des victimes de l’esclavage et du commerce transatlantique des esclaves, le Secrétaire général de l’ONU a pris la parole devant l’Assemblée générale pour dénoncer les horreurs de cette période tragique et appeler à une prise de responsabilité collective de la part des nations encore marquées par cet héritage. Ses propos, poignants et directs, ont souligné la nécessité de reconnaître les injustices passées et de réparer les torts persistants qui en découlent.
Le discours d’Antonio Guteres a été sans détour : «Le commerce transatlantique des esclaves est une tache indélébile dans la conscience de l’humanité.»Ce commerce, qui a duré plus de quatre siècles, a été un système brutal qui a déshumanisé des millions d’Africains, arrachés à leurs familles et communautés, maltraités, contraints de travailler dans des conditions inhumaines, et souvent dépouillés de leur dignité humaine. La profondeur et l’échelle de cette cruauté, a-t-il souligné, sont incompréhensibles.
Les traces de cette violence continuent de se faire sentir aujourd’hui. Des communautés décimées, des familles séparées, et une histoire de souffrance vécue par des millions de personnes sont des héritages indélébiles. Cependant, dans cette période de terreur, il y a aussi eu des actes de résistance, comme la révolution haïtienne et le chemin de fer clandestin aux États-Unis, qui ont montré la force du courage humain face à l’injustice.
Le Secrétaire général a exprimé sa «profonde honte» quant à l’implication de nombreux pays, y compris le sien, dans ce commerce immoral. Une ironie cruelle s’ajoute à cette histoire : lorsque l’esclavage a été officiellement aboli, ce n’étaient pas les esclaves qui ont été indemnisés, mais les esclavagistes. Ces derniers ont reçu des réparations équivalentes à des milliards de dollars d’aujourd’hui. Pire encore, certains esclaves ont même été contraints de payer des compensations pour leur propre émancipation, comme ce fut le cas en Haïti.
Le Secrétaire général a également mis en évidence les héritages persistants du racisme et des idéologies qui ont permis le commerce des esclaves. «Le racisme systémique est profondément enraciné dans nos institutions, nos cultures et nos systèmes sociaux», a-t-il insisté. En effet, les discriminations raciales et les violences subies par les descendants d’Africains sont toujours d’actualité, menaçant leur bien-être et leurs opportunités.
Les leaders africains et caribéens ont récemment mis en avant des appels vigoureux en faveur de la justice réparatrice. Des musées et des espaces publics commencent à honorer la résistance des peuples afrodescendants et à célébrer leurs contributions. Mais le Secrétaire général a insisté sur le fait qu’il fallait aller au-delà de simples symboles : «Ce n’est qu’un début», a-t-il précisé, soulignant la nécessité d’une action concrète pour guérir les blessures du passé.
Les Nations Unies ont un rôle clé à jouer dans ce processus, a rappelé le Secrétaire général. Les États doivent s’engager à respecter leurs obligations internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les entreprises doivent aussi prendre leurs responsabilités en matière d’égalité et de lutte contre le racisme, et la société civile doit continuer de défendre ces valeurs de justice.
Le discours s’est terminé par un appel à l’unité mondiale pour éradiquer le racisme et protéger les droits de l’homme. Le Secrétaire général a réaffirmé que la dignité humaine de chaque individu est le fondement même des Nations Unies, et que la lutte contre le racisme et pour la justice est l’une des missions essentielles de l’Organisation.Zaynab SANGARÈ