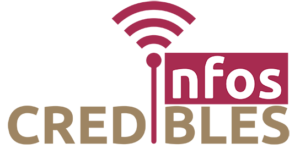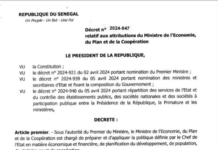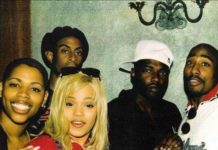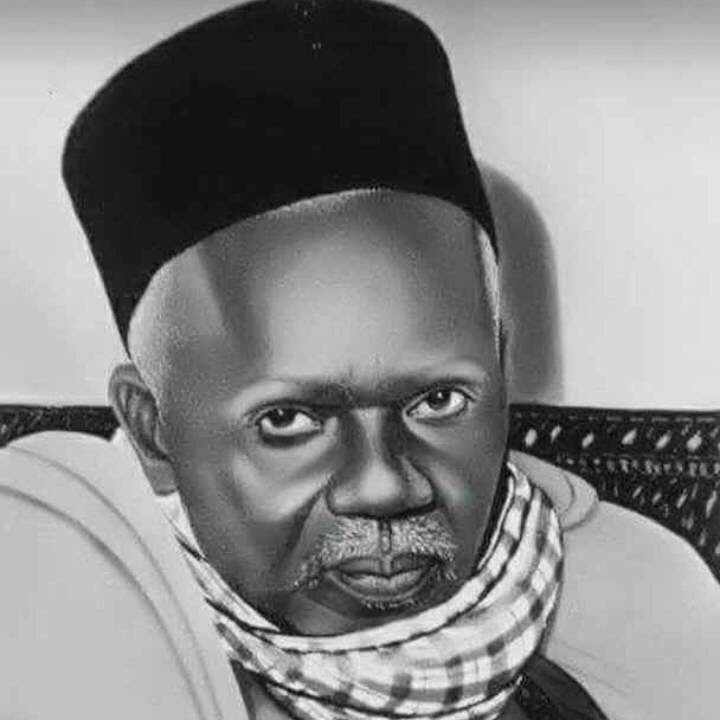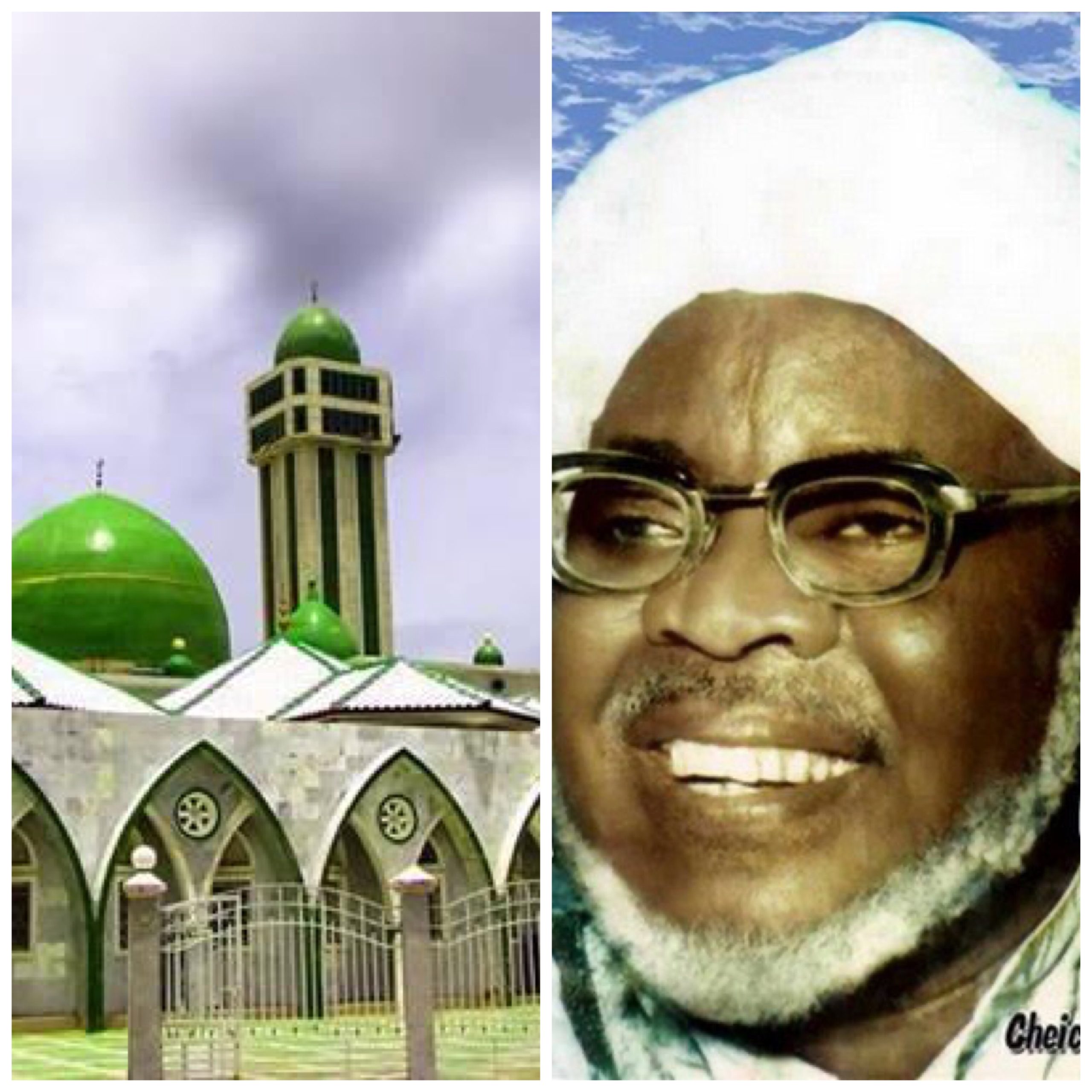Les programmes d’inclusion économique, conçus pour améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres, ont connu une croissance significative ces dernières années. Selon le Rapport sur l’inclusion économique 2024, le nombre de programmes d’inclusion économique a presque doublé, passant de 219 programmes dans 75 pays en 2021 à 405 programmes dans 88 pays. De plus, la couverture de ces programmes a augmenté de 50%, atteignant plus de 15 millions de ménages, soit plus de 70 millions de personnes bénéficiant directement ou indirectement de ces initiatives.
Cette expansion rapide des programmes d’inclusion économique est en grande partie due à l’extension des programmes de protection sociale par les gouvernements en réponse à des crises multiples. En effet, les gouvernements ont intensifié leurs efforts pour faire face aux défis liés à la pauvreté et aux chocs économiques, en particulier après la pandémie de COVID-19.
Les résultats des programmes sont encourageants. Une analyse récente indique des ratios coûts-avantages allant de 121% à 379%, et des taux de rendement internes variant de 16% à 66%. Par exemple, un programme au Niger a présenté un rapport coût-avantages de 127% seulement 18 mois après sa mise en œuvre, tandis qu’en Zambie, un autre programme a atteint le seuil de rentabilité en 12 mois, avec un retour sur investissement de 36%.
Cependant, malgré ces résultats positifs, des défis considérables demeurent. Actuellement, les programmes d’inclusion économique ne couvrent qu’une fraction de la population mondiale vivant dans la pauvreté. La majorité des populations les plus pauvres et vulnérables reste en dehors de ces programmes. L’extension à une plus grande échelle est nécessaire, mais il est également important d’évaluer la rentabilité des programmes à grande échelle dans divers contextes. L’adoption de méthodes plus flexibles et accessibles, telles que le mentorat de groupe et l’utilisation d’outils numériques pour la formation, pourrait améliorer l’efficacité et le rapport coût-efficacité des programmes.
Les questions de l’emploi, notamment pour les jeunes, et de l’autonomie économique des femmes restent également des défis majeurs. Les programmes actuels doivent évoluer pour mieux répondre aux besoins de ces groupes vulnérables.
Simultanément, la situation des enseignants dans le monde soulève des préoccupations importantes. La pénurie d’enseignants est devenue un problème majeur, notamment en Afrique. Selon l’UNESCO, le déficit d’enseignants est estimé à 44 millions à l’échelle mondiale, dont 6 millions de postes à pourvoir dans l’éducation de la petite enfance. Les conditions de travail des enseignants sont également dégradées, avec des salaires insuffisants, notamment dans l’enseignement primaire et l’éducation de la petite enfance. Un enseignant sur quatre considère son salaire comme insuffisant, et dans l’enseignement supérieur, la pandémie a entraîné un gel des salaires.
En outre, les enseignants consacrent une part importante de leur temps à des tâches autres que l’enseignement, telles que la préparation des cours, la correction des copies et diverses tâches administratives. Ces charges de travail supplémentaires sont une source de frustration et d’insatisfaction parmi le corps enseignant. Le Syndicat japonais des enseignants (ZENKYO) a révélé que les enseignants travaillaient en moyenne 96 heures et 10 minutes supplémentaires par mois, ce qui a conduit à des allégations de non-respect des recommandations internationales concernant la profession enseignante.
En réponse à ces défis, plusieurs recommandations ont été émises. Il est urgent d’investir dans le personnel enseignant et d’améliorer leurs conditions de travail, en particulier en matière de rémunération et de soutien administratif. Une formation adéquate doit être fournie aux enseignants, et il est crucial d’améliorer la supervision et la responsabilité au niveau mondial. Un dialogue social renforcé avec les organisations d’enseignants pourrait également aider à résoudre ces problèmes. Par ailleurs, les recommandations internationales concernant la profession enseignante doivent être adaptées aux réalités contemporaines afin de mieux répondre aux besoins du secteur éducatif mondial.
En fin, bien que les programmes d’inclusion économique aient montré des résultats positifs, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour étendre leur portée et améliorer leur efficacité. Parallèlement, la crise des enseignants, alimentée par des pénuries et des conditions de travail dégradées, compromet la qualité de l’éducation. Il est impératif de prendre des mesures urgentes pour investir dans l’éducation et améliorer la situation des enseignants à l’échelle mondiale. Seule une action concertée, reposant sur la transparence, la bonne gouvernance et une coopération internationale renforcée, permettra de relever ces défis cruciaux pour le développement global.